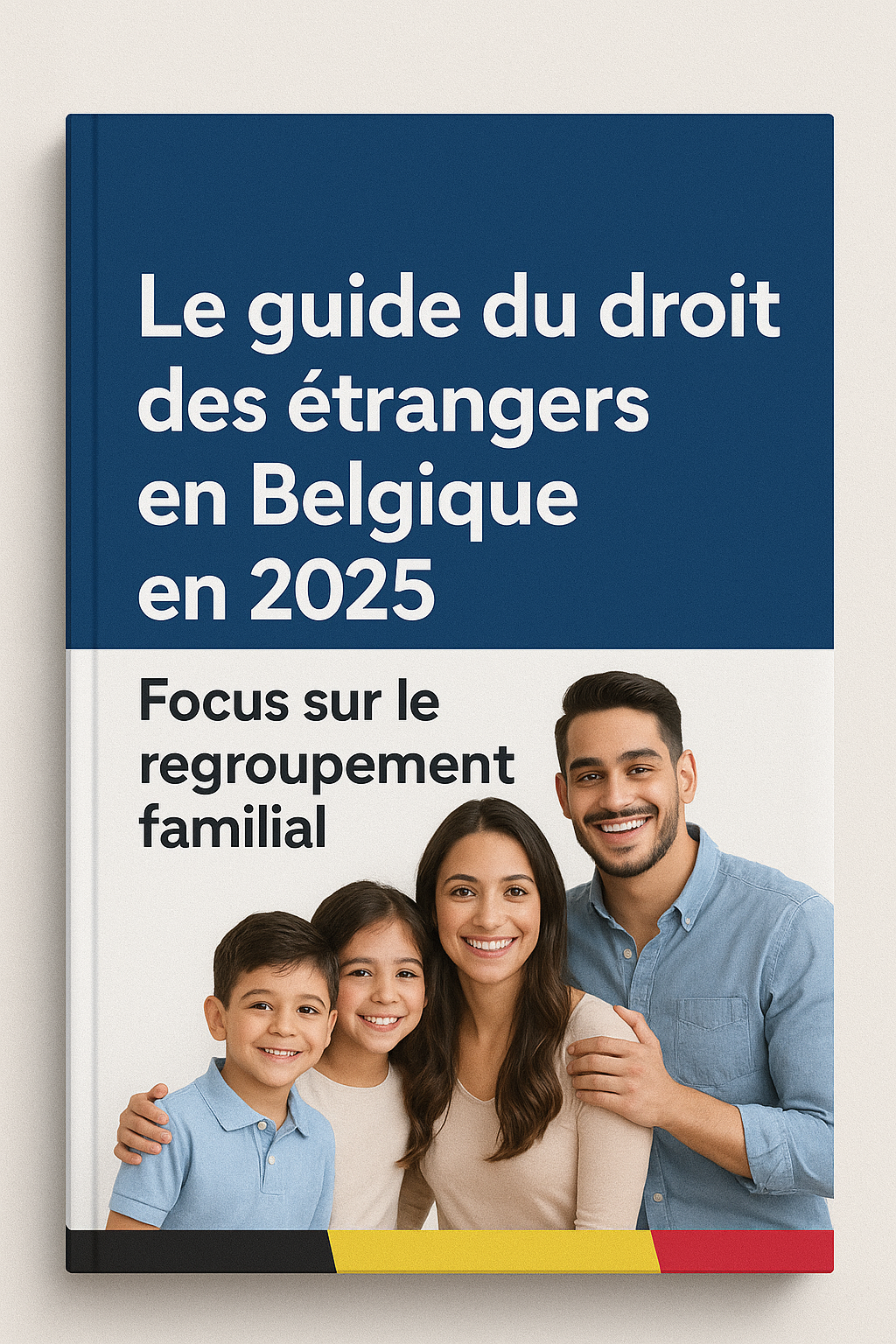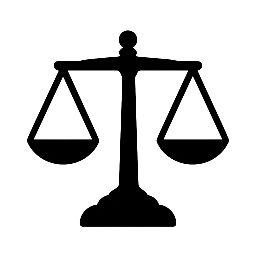Le regroupement familial est l’un des principaux canaux d’entrée légale sur le territoire belge. Ce mécanisme permet à un ressortissant étranger résidant légalement en Belgique de faire venir sa famille. Mais en 2025, ce droit connaît un tournant majeur sous l’impulsion du nouveau gouvernement fédéral dirigé par Bart De Wever, avec à la manœuvre Anneleen Van Bossuyt, nouvelle ministre de l’Asile et de la Migration.
Dans un contexte de durcissement de la politique migratoire, la réforme du regroupement familial soulève autant de soutiens que de critiques, tant sur le fond que sur la forme. Décryptage des nouveautés et de leurs implications.
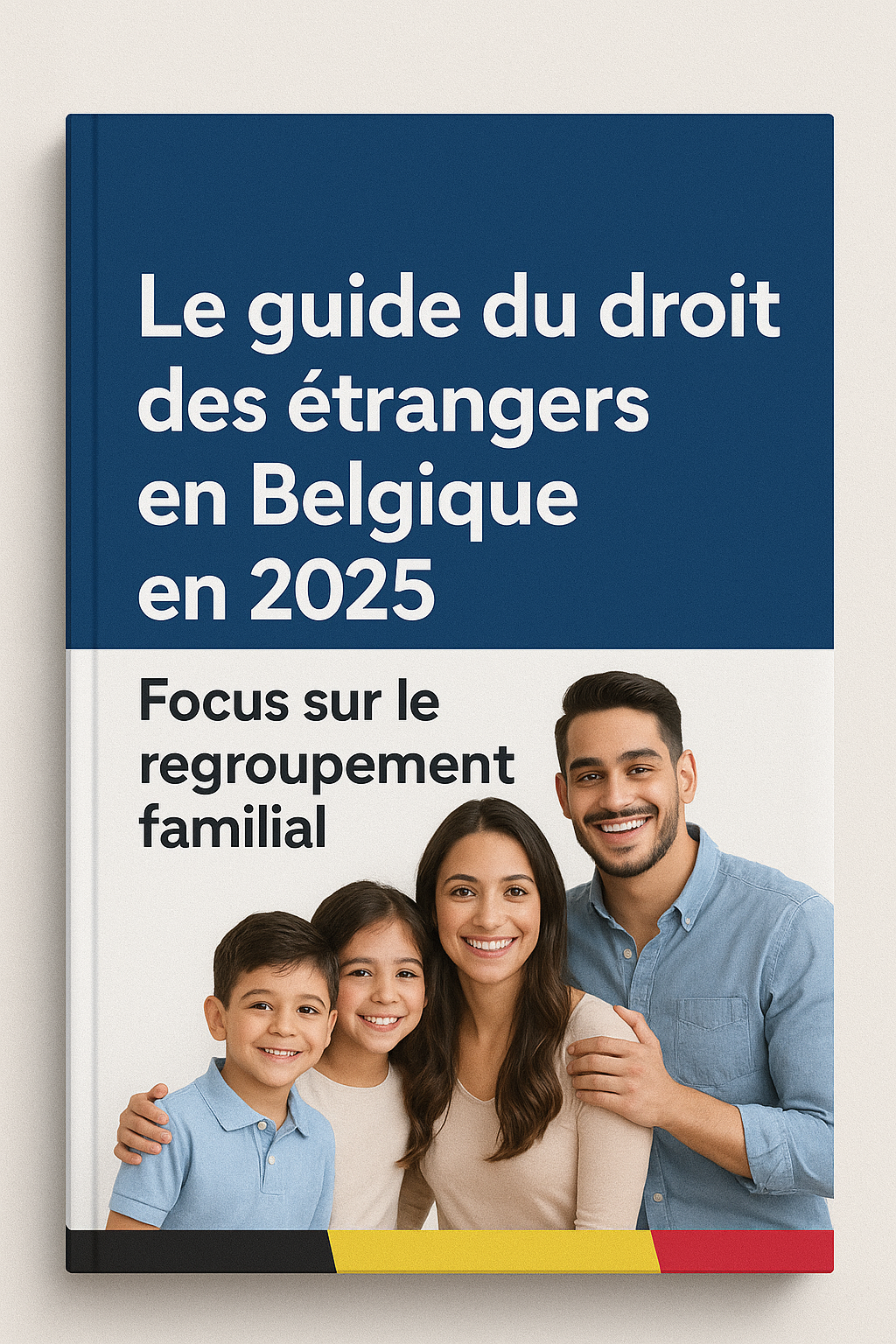
Une nouvelle ministre à la ligne dure
Anneleen Van Bossuyt (N-VA), nommée ministre fédérale de l’Asile et de la Migration début 2025, incarne un changement de cap radical dans la gestion des flux migratoires. Très active sur les questions de sécurité, d’intégration et de contrôle, elle entend mettre en place ce qu’elle décrit comme la politique migratoire la plus stricte de l’histoire belge.
L’objectif affiché : réduire les arrivées jugées incontrôlées, protéger le système social belge, et limiter les abus. Le regroupement familial, bien qu’inscrit dans les droits fondamentaux, est dans le viseur du gouvernement comme un vecteur secondaire mais puissant de migration.
Les principales mesures de durcissement
Le gouvernement a adopté en 2025 un ensemble de mesures législatives modifiant profondément le droit au regroupement familial. Voici les changements majeurs :
1. Revenu minimum exigé plus élevé
Désormais, pour pouvoir faire venir sa famille, le demandeur devra justifier de revenus équivalents à 110 % du revenu minimum mensuel garanti (soit environ 2 323 € nets/mois), avec une augmentation de 10 % par membre supplémentaire à charge. Cela exclut de fait une partie significative des travailleurs précaires, intérimaires ou à temps partiel.
2. Délai d’attente allongé
Un nouveau délai de deux ans est instauré avant de pouvoir introduire une demande de regroupement familial. Ce délai peut être ramené à un an si des liens familiaux existaient déjà avant l’arrivée en Belgique. Ce mécanisme vise à éviter les arrivées rapides de familles entières juste après l’obtention d’un titre de séjour.
3. Disparité entre réfugiés et protégés subsidiaires
Jusqu’ici, les bénéficiaires de la protection subsidiaire bénéficiaient d’un traitement similaire à celui des réfugiés pour le regroupement familial. Désormais, cette catégorie voit disparaître la période d’exemption de conditions (revenus, logement, assurance, etc.), ce qui crée une inégalité de traitement critiquée par de nombreuses organisations.
4. Âge minimum pour les conjoints
Pour limiter les mariages précoces ou forcés, l’âge minimum pour faire venir un conjoint ou partenaire dans le cadre du regroupement familial est désormais fixé à 21 ans, contre 18 ans auparavant.
5. Suppression de l’acceptation tacite
Jusqu’ici, en cas d’absence de réponse de l’administration dans un délai de 9 mois, la demande était implicitement acceptée. Cette règle est supprimée : l’absence de réponse vaut désormais refus, renforçant le pouvoir discrétionnaire de l’administration.
6. Présence physique obligatoire au consulat
Les membres de la famille doivent impérativement se présenter en personne dans une ambassade ou un consulat belge pour déposer leur demande. Cette obligation rend le regroupement difficile pour les personnes vivant dans des zones en guerre ou sans représentation belge.
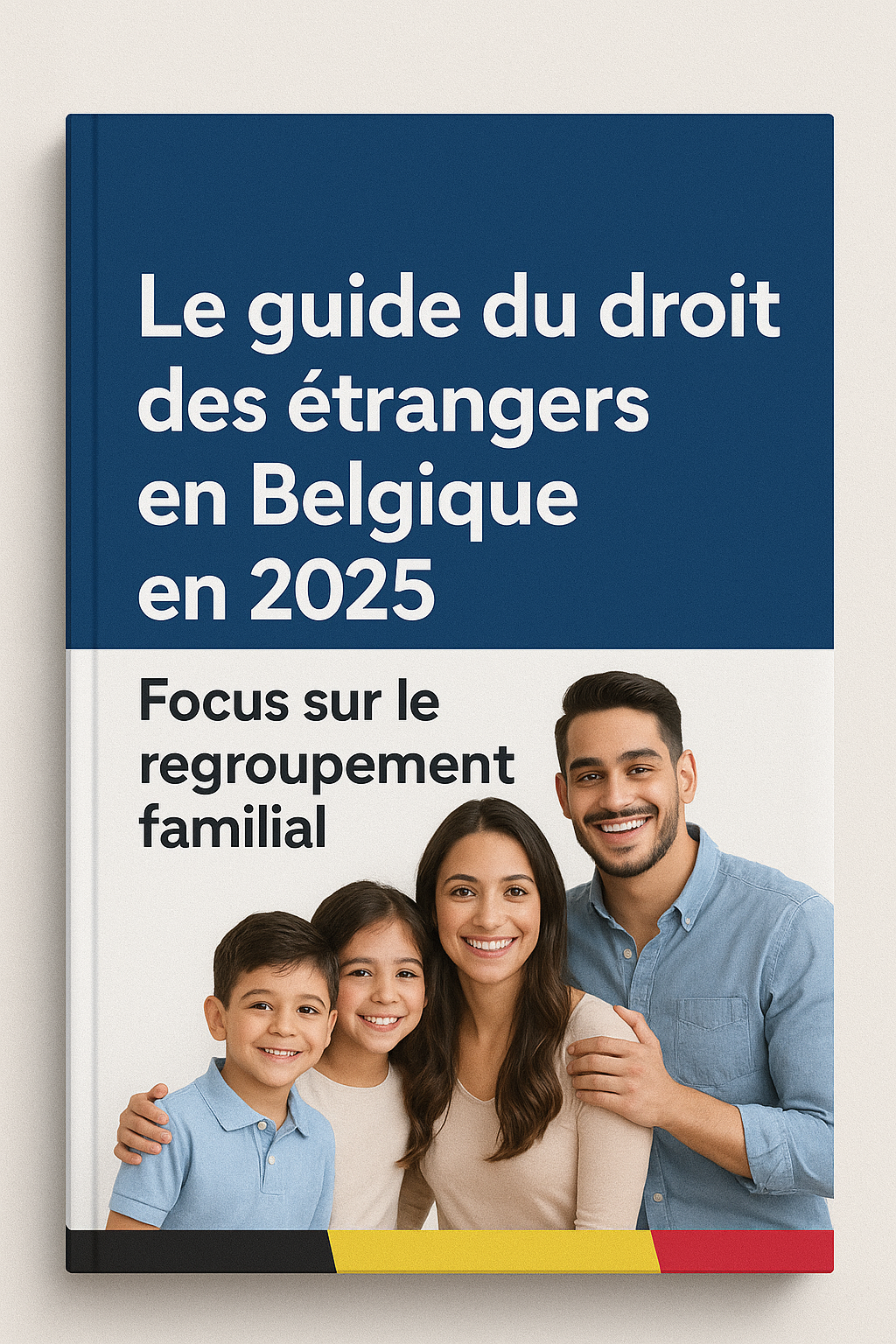
Des critiques sur le fond et la forme
Les nouvelles mesures sont loin de faire l’unanimité. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer une réforme jugée discriminatoire, déséquilibrée et potentiellement contraire aux droits fondamentaux.
Une atteinte au droit à la vie familiale
De nombreuses organisations de défense des droits humains estiment que ces mesures portent atteinte au droit fondamental à la vie familiale, inscrit dans la Convention européenne des droits de l’homme. Les délais rallongés, les obstacles financiers et les démarches compliquées éloignent durablement les familles.
Un impact sur les enfants et les réfugiés
Les enfants mineurs non accompagnés, déjà vulnérables, sont les premières victimes collatérales du durcissement. Le regroupement familial permettait jusque-là à ces jeunes de retrouver leurs parents. Désormais, les conditions plus strictes risquent de prolonger l’isolement, voire d’encourager les filières illégales.
Une charge administrative accrue
La fin de l’acceptation implicite et la demande de présence consulaire risquent d’allonger les délais de traitement, déjà souvent supérieurs à 9 mois, et de saturer davantage les services consulaires.
Les arguments du gouvernement
Du côté de la ministre Anneleen Van Bossuyt, ces critiques sont rejetées. Selon elle, ces mesures sont nécessaires pour restaurer la crédibilité du système d’asile, éviter les abus, protéger les finances publiques, et garantir une meilleure intégration des personnes déjà présentes sur le territoire.
Elle affirme que le regroupement familial ne peut devenir un canal automatique de migration, sans contrôle ni conditions. L’accent est mis sur la responsabilisation des demandeurs et leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille.
Vers une adoption définitive
Le projet de loi a été approuvé en deux lectures par la commission parlementaire compétente, avec un vote de la majorité gouvernementale. L’adoption définitive du texte en séance plénière est attendue avant la fin de l’été 2025, avec une entrée en vigueur prévue à l’automne.
Certains partis d’opposition ont annoncé vouloir saisir la Cour constitutionnelle s’ils estiment que la réforme viole les droits fondamentaux. Le bras de fer juridique et politique ne fait donc que commencer.
En résumé
Le regroupement familial en Belgique en 2025 se retrouve profondément transformé. Ce qui était un droit relativement accessible devient désormais un parcours administratif complexe, conditionné à des seuils stricts de revenus et de durée de séjour. La réforme portée par Anneleen Van Bossuyt reflète une orientation politique claire vers plus de restriction migratoire, au nom de la cohésion sociale et du contrôle des flux.
Mais cette politique soulève aussi de nombreuses questions éthiques et juridiques : équilibre entre sécurité et humanité, entre maîtrise des flux et respect des droits humains. Ce débat, essentiel, ne manquera pas de s’intensifier à mesure que les premiers effets concrets de la réforme seront visibles sur le terrain.