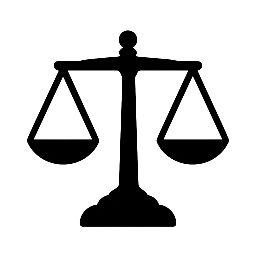Depuis plusieurs années, la Belgique a durci les règles encadrant le regroupement familial. En 2025, la question des ressources financières est devenue un critère déterminant, voire discriminant, dans l’acceptation ou le refus des demandes. Ce glissement progressif transforme le droit fondamental de vivre en famille en un privilège réservé à ceux qui peuvent prouver leur autonomie économique.
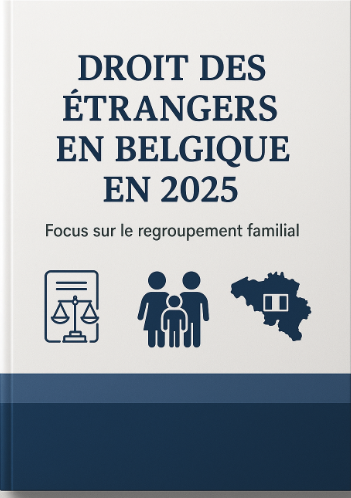
Une évolution législative marquée par le contrôle budgétaire
Le regroupement familial est encadré en Belgique par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’éloignement. Si le droit à la vie familiale est reconnu, il n’est pas absolu. Depuis les réformes successives de 2011, 2013, puis 2024, le législateur insiste de plus en plus sur la condition de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants.
En 2025, pour pouvoir faire venir un membre de sa famille (époux.se, enfant, parent), le demandeur doit prouver qu’il dispose de ressources mensuelles équivalentes à 120 % du revenu d’intégration sociale. Concrètement, cela représente un minimum d’environ 2 200 à 2 400 euros nets par mois, selon la composition du ménage.
Une logique économique plus qu’humaine
Cette exigence traduit une volonté politique claire : filtrer les candidats au regroupement familial selon leur statut socio-économique. L’argument mis en avant est le coût potentiel pour l’État en matière d’aides sociales. Le gouvernement entend ainsi éviter « l’importation » de la précarité, en imposant un seuil élevé de ressources.
Mais dans les faits, cette condition écarte une grande partie des travailleurs précaires, des indépendants aux revenus instables, ou des femmes en temps partiel. Même des salariés à temps plein peuvent avoir des difficultés à atteindre ce seuil s’ils ne gagnent qu’un peu plus que le salaire minimum.
Des preuves de revenus de plus en plus strictes
Outre le montant des ressources, leur stabilité et leur régularité sont également exigées. Il ne suffit plus de présenter un contrat de travail récent. Les autorités exigent :
- des fiches de paie sur 12 mois ;
- une preuve de contrat à durée indéterminée ou longue durée ;
- des déclarations fiscales complètes.
Les indépendants doivent quant à eux produire leurs comptes annuels, leurs déclarations TVA, et parfois des attestations du comptable, ce qui rend la procédure encore plus complexe.
Le SPF Intérieur ou l’Office des étrangers ont souvent une lecture restrictive de ces critères. Le moindre doute sur la stabilité des revenus peut entraîner un refus de regroupement familial.
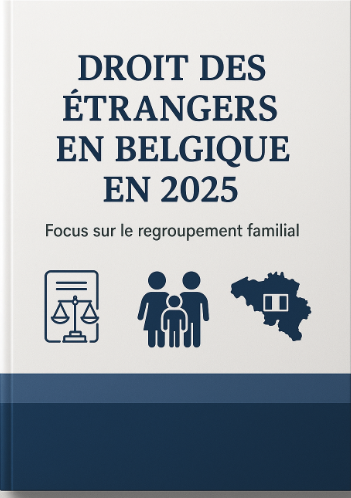
Les réfugiés et les bénéficiaires de protection internationale toujours en difficulté
Bien que le législateur ait prévu des conditions dérogatoires pour certains publics vulnérables (réfugiés reconnus, bénéficiaires de protection subsidiaire), les barrières financières sont parfois indirectes.
En théorie, les réfugiés peuvent introduire une demande sans justifier de revenus, mais en pratique :
- Les délais de regroupement familial sont courts (3 mois après la reconnaissance du statut) ;
- Les délais de traitement restent lents et opaques, parfois 9 mois ou plus ;
- Le dépôt depuis la Belgique n’est pas toujours autorisé, ce qui implique des démarches coûteuses à l’étranger.
Ces contraintes génèrent de l’angoisse, de la fracture familiale, et parfois le renoncement à entamer une procédure.
Une inégalité territoriale et sociale croissante
Le regroupement familial n’est donc plus une garantie automatique, mais une démarche à haut risque juridique et économique, dont les chances de réussite varient fortement selon le profil du demandeur.
Par exemple :
- Un cadre ou fonctionnaire belge aura peu de difficultés à répondre aux exigences ;
- Un jeune travailleur en intérim ou une mère isolée rencontrera beaucoup d’obstacles ;
- Un demandeur vivant en Wallonie rurale touchant un revenu plus bas que la moyenne urbaine flamande ou bruxelloise sera désavantagé.
Ce système introduit une double discrimination : sociale (revenu) et territoriale (marché de l’emploi local).
Une barrière administrative aux conséquences humaines profondes
Ce filtrage par les revenus a des conséquences humaines considérables. Séparations prolongées, enfants privés d’un de leurs parents, couples vivant à distance, démarches répétées et coûteuses : le coût émotionnel est immense.
Les ONG telles que le CIRÉ ou Caritas International dénoncent cette évolution comme une déshumanisation du droit au regroupement familial. Vivre en famille devient un luxe réservé aux classes moyennes et supérieures.
Vers une remise en question du modèle ?
Face aux critiques croissantes, certains parlementaires européens et belges appellent à rééquilibrer la politique migratoire, pour qu’elle respecte à la fois les objectifs économiques de l’État et les droits fondamentaux.
Des pistes envisagées :
- Revoir à la baisse le seuil de revenus exigé ;
- Mieux encadrer l’appréciation des autorités (avec plus de transparence et de recours rapides) ;
- Réintroduire des garanties pour les familles vulnérables (protection humanitaire).
Mais pour l’instant, la tendance reste au durcissement, avec une probable hausse des seuils en 2026.
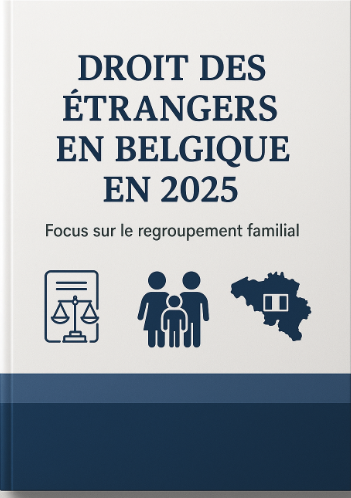
Conclusion
En 2025, la Belgique a transformé le regroupement familial en un parcours d’obstacles économiques. Le revenu est devenu le filtre principal qui sépare les familles capables de se réunir de celles qui resteront séparées. Derrière une logique budgétaire se cache une fracture humaine, qui met en jeu les principes les plus fondamentaux du vivre ensemble. Pour que le droit à la vie familiale reste un droit, et non un privilège, un débat public s’impose.